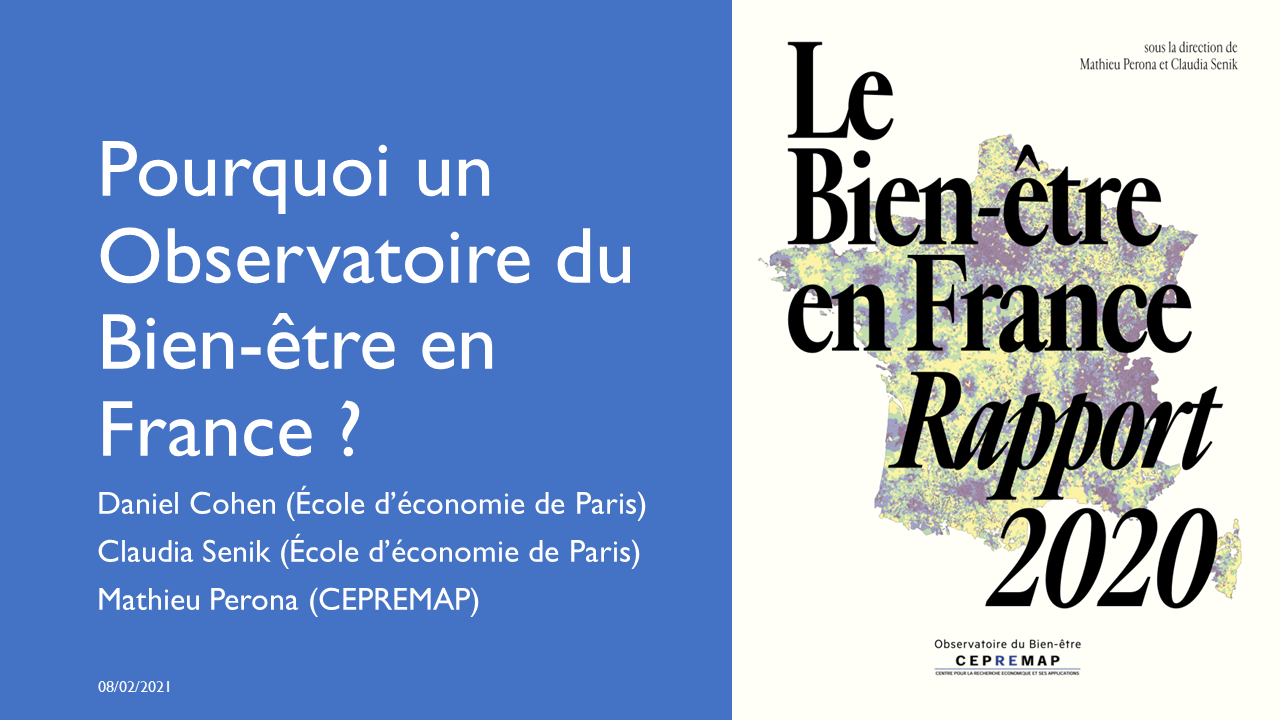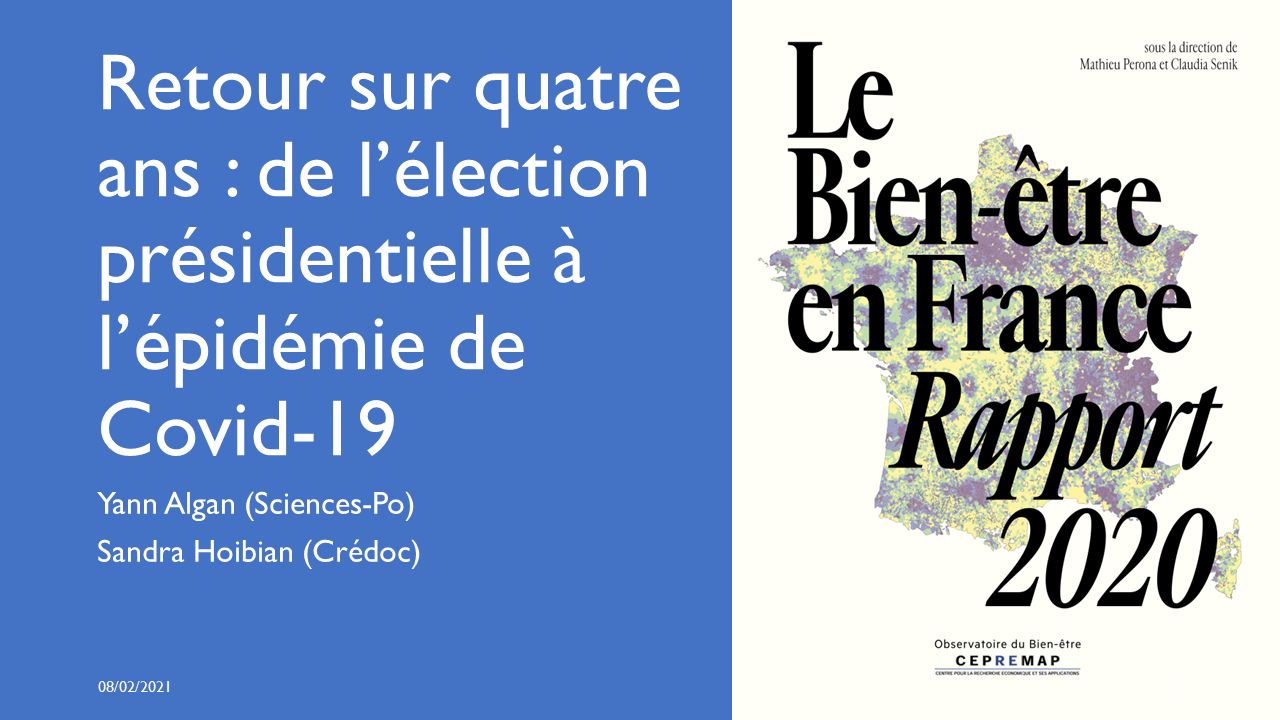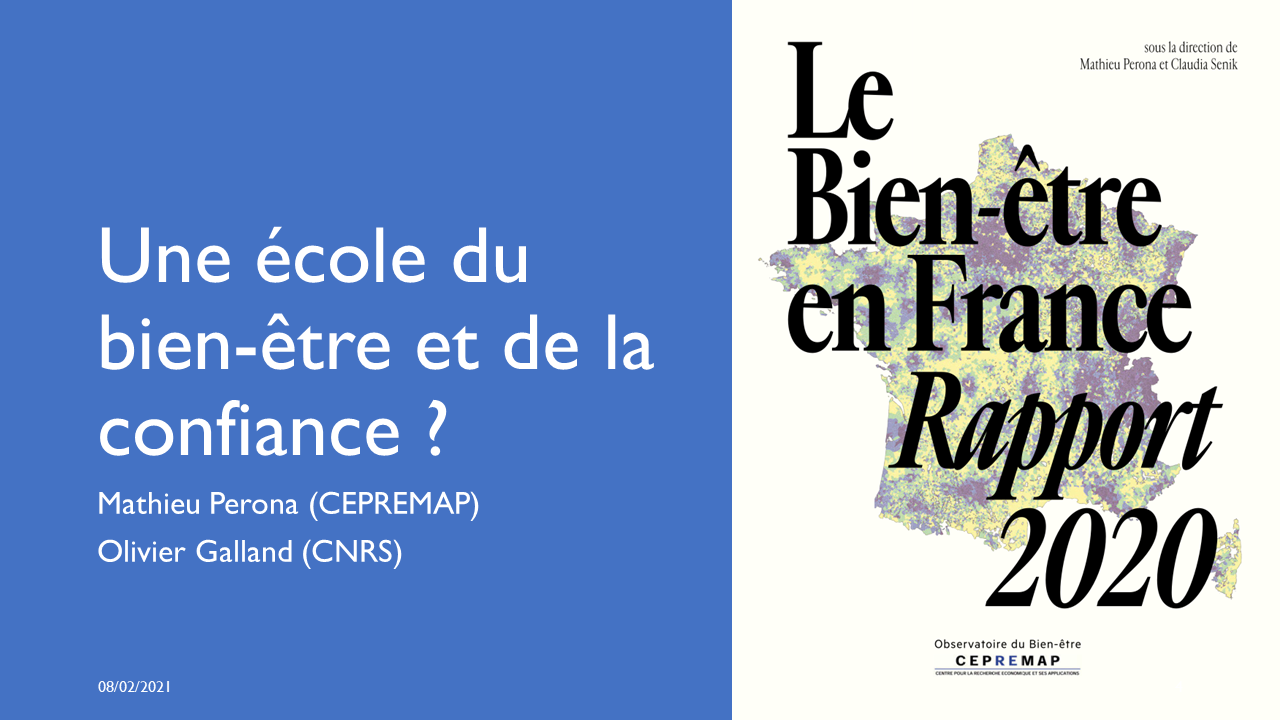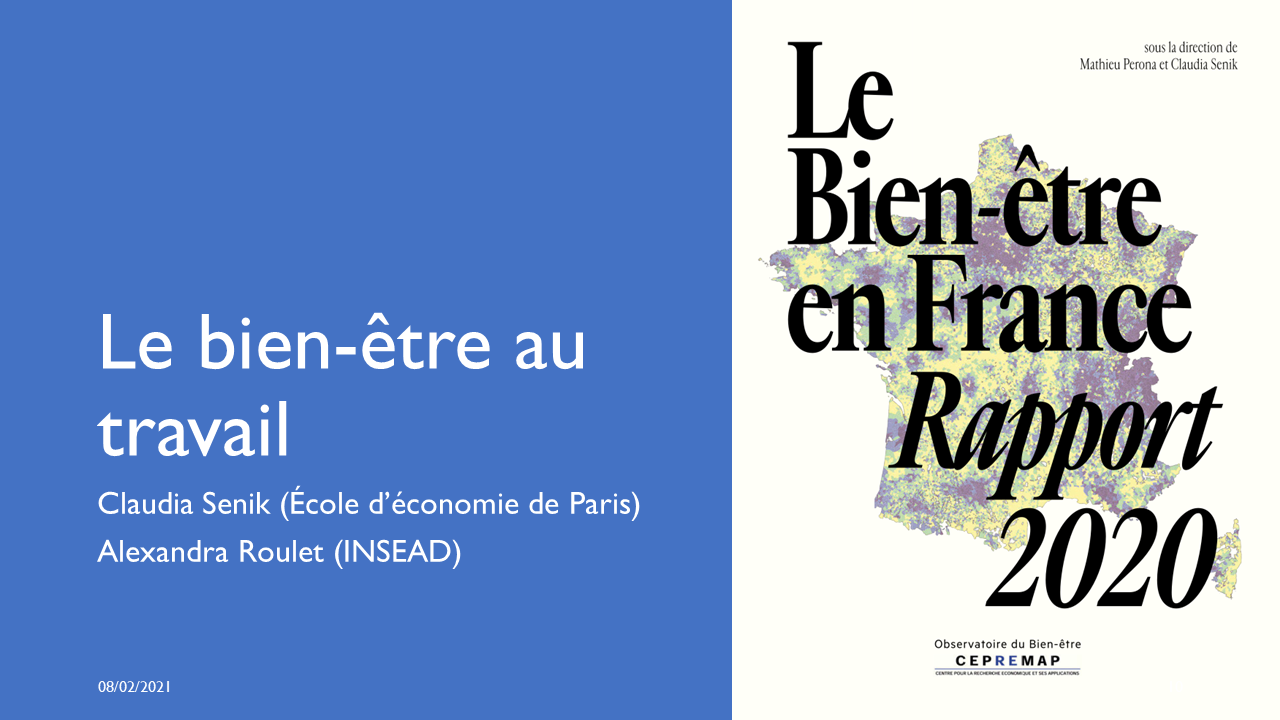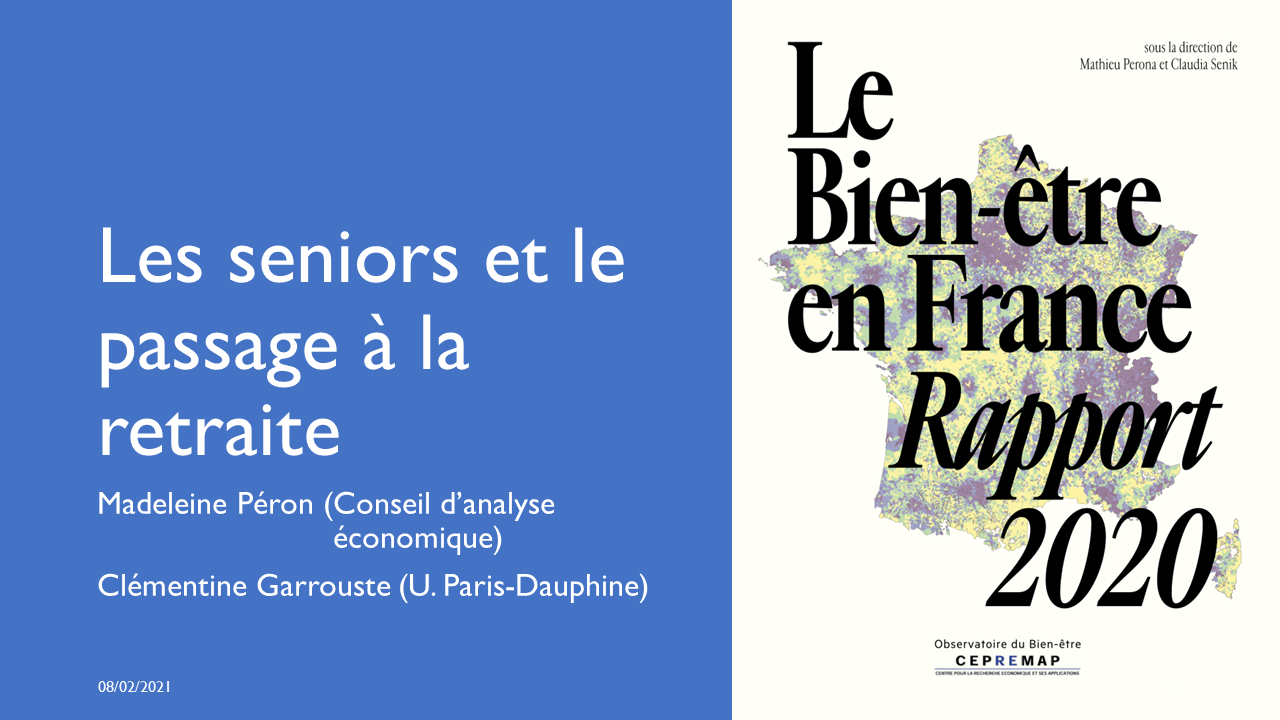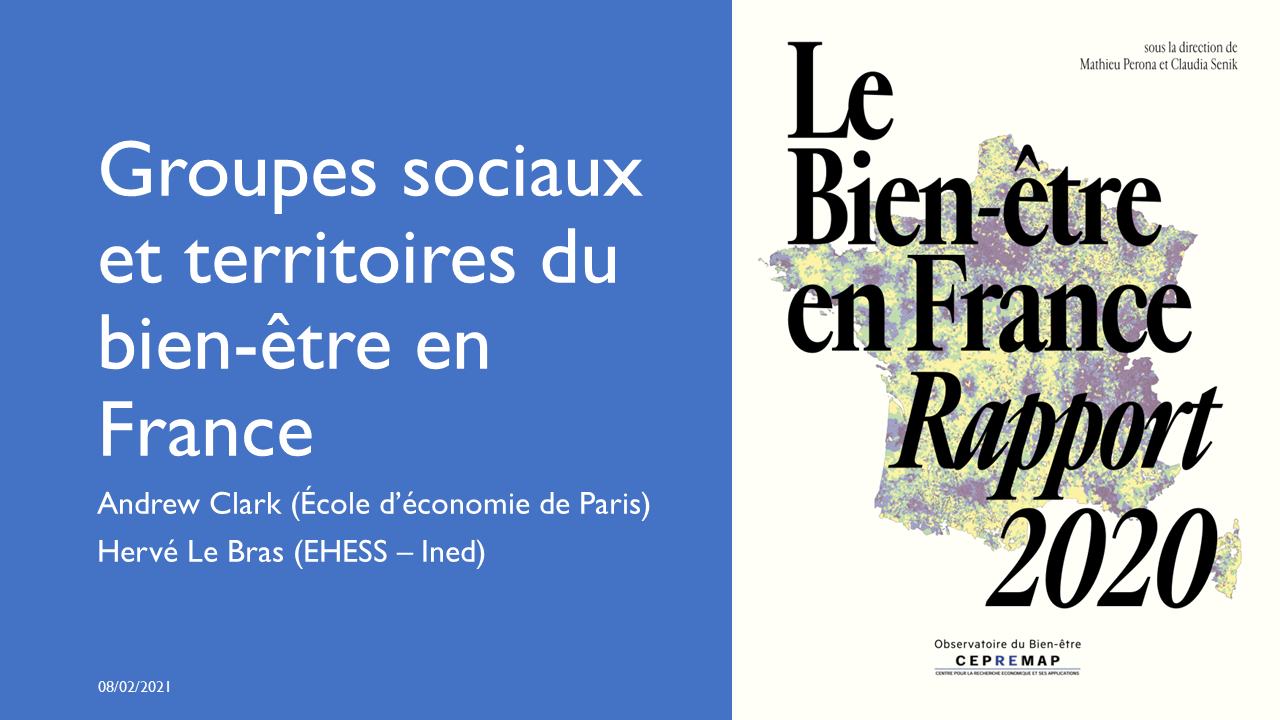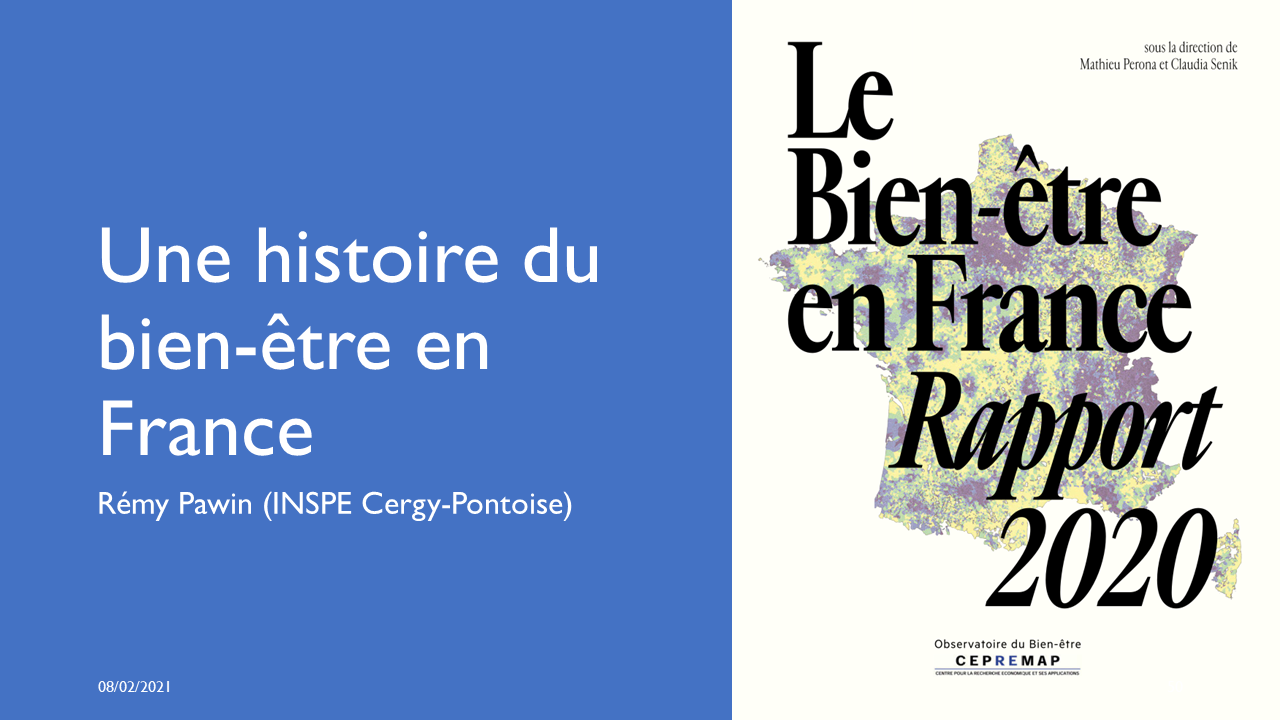- « À la recherche du bonheur perdu des Français », Les Echos, par Jean-Marc Vittori, 26 mars 2021
- Entretien avec Claudia Senik et Mathieu Perona, Le 13/14, France Inter, Bruno Duvic, 05 mars 2021
- « Les Français sont particulièrement insatisfaits et pessimistes concernant leur vie et celle du pays », Le Monde, entretien avec Ariane Chemin, 03 mars 2021
- Entretien avec Yann Algan et Claudia Senik, Les Matins de France Culture, Guillaume Erner, lundi 08 février 2021
- « Hauts et bas du bien-être des Français en 2020 », Alternatives économiques, Gabriel Gérardin, 12 février 2021
Le Bien-être en France : Rapport 2020
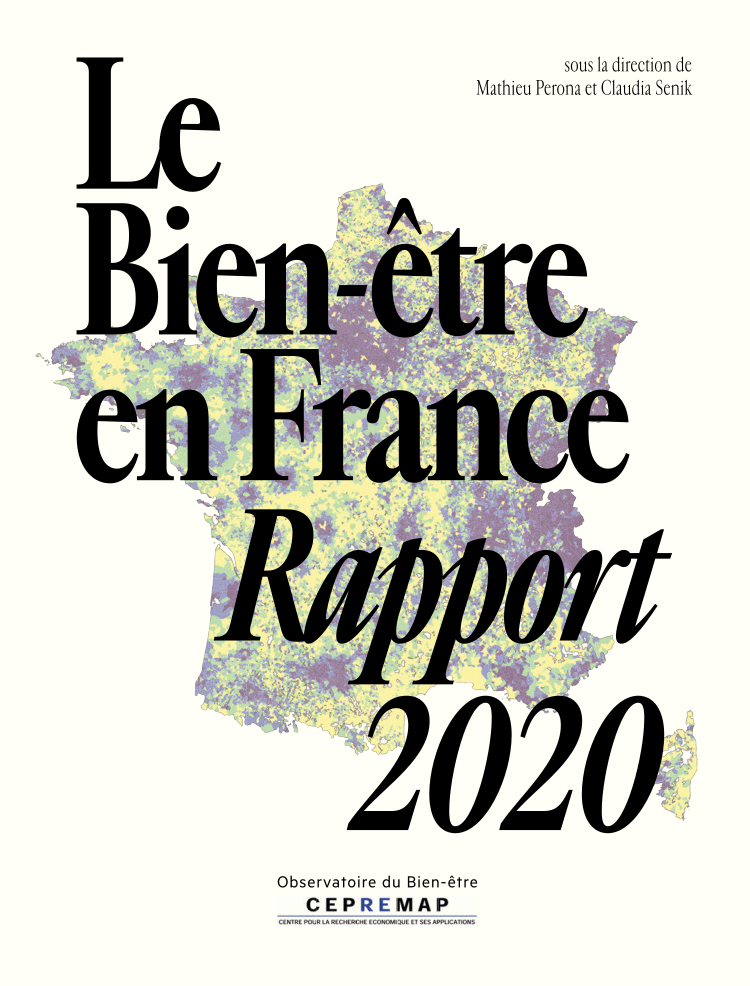
Mathieu Perona (dir.) et Claudia Senik (dir.)
Février 2021
La presse en parle
Résumé
Sommaire
- Introduction : Pourquoi faire un portrait du bien-être en France ?
- Tableau de bord du bien-être en France
- La France dans l’Europe du bien-être subjectif
- Retour sur trois ans d’enquêtes trimestrielles
- La France face au Covid-19
- Heurs et malheurs du confinement
- Les impacts psychiques et politiques du Covid : une comparaison France, Allemagne, Royaume-Uni
- L’éducation
- Le rôle de l’école dans le cycle de vie
- Une école du bien-être et de la confiance ?
- Bien-être au travail
- Le bien-être au travail
- La satisfaction au travail, une perspective européenne
- L’insatisfaction au travail
- Confiance et lien social au travail
- Les seniors
- Les seniors en Europe
- Le passage à la retraite
- Groupes sociaux et territoires
- Portrait social de l’insatisfaction
- Territoires du bien-être
- Mesurer le bien-être au niveau local
- Une histoire du bonheur en France
En bref
Depuis sa création, il y a quatre ans, l’Observatoire du bien-être se donne la mission de scruter le bien-être des Français ; le présent rapport vise à donner une image de cette activité, et ce faisant, à dresser un portrait de la France au prisme du bien-être subjectif.
Le travail, d’abord, qui joue un rôle primordial dans la satisfaction, non seulement à cause du revenu qu’il procure, mais aussi par les relations sociales qu’il occasionne et du sens qu’il donne à l’activité individuelle. C’est d’ailleurs surtout à travers la sphère professionnelle que le niveau d’éducation contribue à la satisfaction. On constate hélas que dans le domaine du travail, peut-être plus que dans tout autre, le célèbre « déficit de bonheur français » s’exprime à travers un niveau d’insatisfaction plus élevé que chez nos voisins européens. C’est peut-être pourquoi, à l’inverse de nombreux pays, le passage à la retraite ne semble pas constituer en France une charnière difficile, de nature à provoquer une baisse de bien-être, même s’il occasionne une perte de revenu. Pour les chômeurs, il représente même une sortie de la précarité et du stigmate, nettement favorable au bien-être.
Les liens sociaux et privés ensuite, dont on mesure l’importance, en creux, par le sentiment de solitude particulièrement délétère qui s’exprime dans certaines communes du territoire français. C’est en effet dans les territoires en déclin démographique, d’où la vie sociale se retire, que l’on a vu récemment se manifester des signes de fort mécontentement : insatisfaction, abstention électorale, et manifestations de Gilets jaunes.
Au total, les Français se classent plus mal que les autres Européens sur un grand nombre de mesures subjectives de bien-être malgré une situation beaucoup moins défavorable en matière d’indicateurs objectifs. Nous y voyons le signe d’une société inquiète, mal à l’aise avec les transformations qui la traversent. Peut-être aussi, dans une société centralisée où l’on attend beaucoup de l’Etat, est-il particulièrement angoissant de voir l’échelle nationale largement dépassée par l’ampleur des changements mondiaux. Le dernier chapitre de cet ouvrage ajoute une profondeur historique à l’analyse, et suggère que la notion de crise, apparue au milieu des années 1970, s’est durablement installée dans la société française, ainsi que le pessimisme et l’insatisfaction qui l’accompagnent.
Ces observations, réalisées au cours des années passées, revêtent une teneur nouvelle à la lumière de la crise du Covid-19. Si le gouvernement fait face à un arbitrage cornélien entre la lutte contre l’épidémie et l’économie, il prend aussi progressivement conscience de la nécessité de préserver le bien-être et la santé mentale de la population.